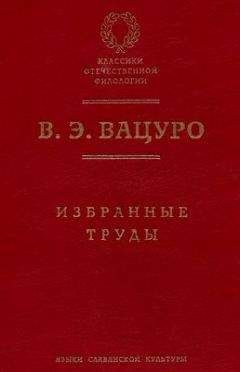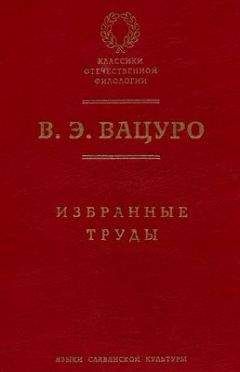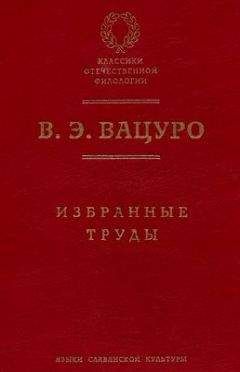Dans tout le cours de cette visite, cependant, j ’ai remarqué chez elle une tendance de me peiner. Elle riait quelquefois d’un rire offensant, elle faisait ressortir l’esprit de Panaïeff aux dépens du mien, etc. etc. Une fois Pa-naïeff a dit à peu près une bêtise, une inconséquence sur mon compte; et bien involontairement, elle en a rit jusqu’aux pâmoisons. Elle a cru que j’en serais piqué, et elle s’y est trompée: je compris son intention et je ris avec elle. Il faut bien autre chose pour me décontenancer. Elle ne connaît pas mon caractère, elle ne sait pas que je supporte tout de la part d’une femme, surtout d’une fem-me aimable, mais je ne supporte point des propos d’un homme et que je sais parer les paroles en décochant traits pour traits, ainsi comme j’ai su dans plus d’une occasion, montrer de la fermeté et me battre avec des armes bien plus graves.
Je suis parti vers 11 heures et demi et à dire la vérité, pas trop content de ma journée.
Dimanche, ce 5 juin 1821.
La soir ée d’hier que j’ai passé chez Izmaïloff, n’a pas été trop bien remplie, je ne sais trop pourquoi. Il y a eu une quinzaine de personnes pres-que toutes mes connaissances. Madame Izmaïloff a un peu diminué de sa sécheresse et de son ton froid qu’elle affecta depuis quelque temps à mon égard, parce que j’ai fait une fois l’éloge de la charmante Mme P… ff en sa présence. C’était encore dans le commencement de ma connaissance avec cet-te aimable dame. Je ne sais pourquoi Mr. Kniagewitsch l’ainé m’a paru piqué d’une plaisanterie toute innocente. Je n’ai pas voulu l’offenser d’aucune ma-nière. Son frère est revenu de Laybach, il m’a fait le récit de son voyage à Venise. Noroff, Ostolopoff et moi nous avons parl é de la littérature italienne, française, et russe. J’ai promis à Noroff de passer chez lui lundi matin. Je l’aime beaucoup, ce brave militaire; la noble marque de sa valeur, une jambe de bois, est le meilleur certificat pour lui aux yeux de ses concitoyens. Je suis rentré à 11 heures et demi, et j’ai rencontré Jakowleff, tout près de la porte; il était venu me dire le bonsoir. Nous avons parlé une demi-heure; Madame a eu aussi sa part dans notre conversation: nous avons parlé de son amabilité et lui avons désiré un caractère un peu moins changeant, et de ne pas traiter avec rigueur les gens qui lui sont bien sincèrement dévoués.
Lundi, 6 Juin, à 7 heures du matin.
La journ ée d’hier m’a tout à f’ait reconcilié avec elle. Je l’ai cru passer bien autrement, cette journée, et je suis enchanté que le proverbe: Homo pro-ponit, Deus disponit avait servi cette fois à mon avantage. A midi j’allais chez Gretsch à la campagne; je l’ai rencontré au quai de Petersbourg, nous avons causé un peu ensemble et puis nous nous sommes séparés. Comme l’heure du dîner était encore très éloignée et que j’étais déjà dehors, par conséquent ne voulant pas rentrer avant d’avoir faire quelque chose, me voilà qui me décide d’aller voir Mme. Je trottais déjà sur le pont de Wibourg, clopin-clopant com-me je le pouvais à cause des bottes qui me torturaient les pieds, lorsque j’ap-perois Mr. Woïeikoff qui courait en droschki à deux places; je le salue, il s’arrête, m’invite à prendre place dans son droschki, et quoique je serais bien content de m’excuser là-dessus, je n’ai pas voulu faire des grimaces, j’accepte donc son offre obligeant d’aller bonne grâce et nous voilà à converser et sur le mauvais temps, et sur l’intempestibilité du climat de St. Petersbourg, et sur la fumée de Londres, et sur les 93 marches de l’escalier de Gretsch, et sur la ma-ladie de Madame Woïeikoff, et sur les talents et l’amabilité de Mr Noroff. Bref, nous avons fait le caquet bon-bec depuis le pont jusqu’à l’Académie de la medicine et chirurgie. Là je l’ai prié de faire arrêter la voiture, disant que j’avais une visite à faire à l’académie. Nous nous sommés dits force compliments et j’ai été très charmé d’avoir éluder une conversation plus longue.
Je viens chez Madame, j ’y trouve Yakowleff et Kouschinnikoff qui arrive un moment après. Madame me reçoit d’abord assez sèchement; elle veut re-tenir Yakoveff qui s’évade. On s’arrange à faire un tour de promenade avec Mme Goffard et les enfants, elle y va en effet. Je l’atteins et la plaisante sur ce qu’elle a l’air d’une maîtresse de pension, elle retourne à la maison. Nous déjeunons, nous parlons, et tout d’un coup elle me fait cadeau d’un mouchoir pour porter en chemise sous le gilet. Nous nous mettons de nouveau en marche pour aller à la campagne où demeurent les enfants de Mme Goffard; notre suite est composée de Mr Ponomareff, Madame, M. Kouschinnikoff, Mme Goffard, Alexandrine et moi. Madame me donne le bras, nous arrivons en face de la campagne de Mr Dournoff et prenons un bateau qui nous transporte jusqu’à la campagne Bezborodko; nous passons par le jardin. Madame me donnait tou-jours le bras pour la mener; au bout du jardin nous trouvons un pont couvert à demi écroulé et qui n’a pour tout plancher que deux poutres touchant le milieu du pont couvert. Je mène Madame avec toutes les précautions et sollicitude possibles; Hector reste au milieu du pont, n’osant point passer; elle l’appelle, il jappe et reste indécis. Je me précipite sur la poutre, je prends le chien sur mes bras, tout crotté qu’il était et je le porte sur l’autre bord, ce qui m’a valu des expressions très aimables, même tendres de la part de Madame. Какая милая попинька: qui aurait fait comme lui. Ces peu de mots m’ont tout à fait cap-tivé et m’ont de nouveau soumis sous ses lois; je ne me sentais pas de joie; je jurais intérieurement d’être toujours à elle. Dans ce moment-ci elle m’a paru plus belle que jamais, et si je l’avais pu je l’aurais étouffé de mes baisers: même j’aurais embrassé mille et mille fois son chien; mais j’ai craint de la compromettre devant les jeux de tant de témoins. Ce son de voix lorsqu’elle dit quelque chose d’aimable, d’obligeant, pénètre dans mon cœur et y attire une nouvelle flamme, je suis alors aux anges et si confus, si heureux, que je ne sais que répondre: les phrases me manquent avec la respiration, je me pâme d’aise. Non! jamais je n’ai été aussi amoureux, j’étais plus jeune et les sensations n’étaient pas encore aussi profondes, aussi décidées.
Le reste de la journ ée s’est passée assez agréablement pour moi. Après diner nous sommes allés en bateau à Krestowsky; là je me suis absenté pour quelques minutes; je les rejoins déjà sur le bateau et j’inventais des excuses et des incidents. Elle m’a pourtant grondé avec assez d’amertume: Toujours nous faites de ces farces; c’est joli! Le malheur est qu’elle s’est mouillée les pieds; moi qui les avais aussi mouillés jusqu’aux genoux, je me taisais. Elle se plaig-nait du froid sur le bateau, et je craignais pour elle. Arrivée à la maison, elle se fait frotter les pieds, à nos instances réitérées, avec du rhum et s’est couchée ensuite. Elle a voulu retenir de force Mme Goffard, Kouschinnikoff et moi, pour passer la nuit à la campagne; mais ensuite elle a consentie à nous laisser partir. Je me suis approché d’elle pour prendre congé… Délayé j’ai vu encore ce beau sein qui fait mon martyre, je fais des efforts pour ne pas me trahir, je ne me possède presque plus. J’imprime un baiser sur sa main et je m’arrache de cette île de Calypso.
J’ai oublié de noter qu’elle m’a grondé pour je ne sais quelles préten-tions lorsque je lui ai demandé le pardon pour je ne sais quelles fautes. Ensui-te elle s’est radoucie, elle m’a marqué du regret de ce que je ne lui écrivais plus, je lui ai renouvellé la prière de me permettre de lui écrire, ce que m’a été accordé.
Mardi, à 11 heures du matin, ce 7 juin.
J ’ai écrit presque toute la matinée du lundi, le cœur et la tête toujours remplis d’elle. Je suis sorti à midi et demi pour aller chez Noroff que je n’ai pas trouvé à la maison. Ensuite, je suis entré chez Slenine, par désœuvrement, et j’y ai trouvé mon colonel à la jambe de bois. Il parcourait quelques ouvrages italiens. Nous sommes allés déjeuner chez Talon; puis nous sommes montés chez Pluchard où nous avons encore parcouru quelques uns de nos chers italiens en attendant le droschki du colonel. Le droschki arriv é nous avons été rentrés à terre chez lui pour prendre la pièce de vers que je dois lire pour lui dans la société. Il me charme de plus en plus cet aimable colonel; pas ombre de la morgue militaire, beaucoup de prévenance et d’honnêtetés; une conversation variée et instructive, il ne paraît pas aussi savant qu’il l’est en effet. Voilà des gens que j’aime parceque j’aime à être toujours avec des gens qui valent mieux que moi: c’est une espèce d’égoïsme, j’en conviens, je gagne ici tandis que je perds mon temps et mes paroles avec ceux que sont plus bêtes que moi. Je suis sûr qu’on est aussi dans les mêmes rapports envers moi, parce que c’est le primo mihi universel.
A 7 heures je suis venu chez Yakowleff: nous avons encore parl é d’elle; c’est elle qui fait les délices de ma conversation. Mais je tâche bien de cacher à Yakowleff mes véritables sentiments, qui tout pénétrant qu’il est ne s’en dou-te guère. Je crois que nous trompons l’un l’autre.
A 8. Je suis all é à la Société; j’ai insisté qu’on élit Noroff comme membre effectif; lorsqu’on est venu en scrutin, il s’est trouvé qu’il y avait 15 votes pour et un seul contre sa réception; il a donc été élu presque à l’unani-mité. J’ai remis à Glynka l’épitre de Noroff à Panayeff où il lui dit que la nature humaine se détériore de plus en plus; beaux vers à quelques incorrections du style près. Glynka l’a lu dans la séance même, et tout le monde l’a approuvé.
Ce 7 Juin 1821.
Vous me pardonnez, Madame! vous me rendez vos bont és! Non! je ne me suis pas trompé, vous tenez de la divinité la plupart de ce que vous êtes, et ces grâces, et cette bonté, tout cela est d’une origine céleste. Eh! Suis-je digne d’un de vos regards, de ces regards qui font tant de bien à celui sur qui vous daignez les arrêter. Oh! si vous aviez vu, combien je souffrais en voulant com-battre, subjuguer une passion qui est devenu pour mon âme ce que les esprits vitaux sont pour le corps de l’homme, — inséparable de mon existence; j’ai cru perdre à jamais les douces illusions de ce bonheur, qui, sans être réel, n’en est pas moins cher pour moi puisqu’il me représente l’image d’un bonheur plus parfait, plus palpable, auquel je n’ose attenter que dans mes rêves.
Il me semble pourtant que vous paraissez quelquefois vous d éfier de la véridité de mon amour. Hélas! est-ce ma faute si cette figure sans expression, si ces yeux sans feu ne vous disent que faiblement ce que j’éprouve? Tout le feu, qui manque à mes yeux et qui n’anime point mes traits, est concentré dans mon cœur: c’est là que vous avez votre autel, où vous êtes sans cesse adorée, encensée. Non! une flamme si forte ne pourra pas mourir même avec mon être, elle me survivra, elle suivra au delà du tombeau et sera pour mon âme le plus bel apanage d’immortalité. Je vous y reverrai. Madame! vous serez l’ange de bonté qui me fera participer à la félicité éternelle: sans vous je n’y trouverais qu’un état de langueur infinissable.